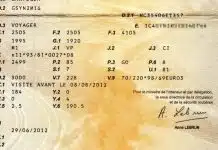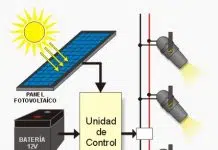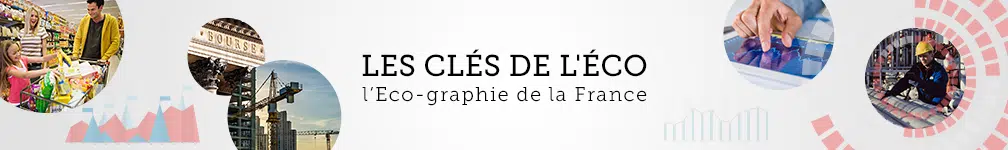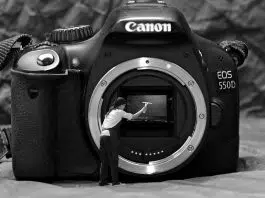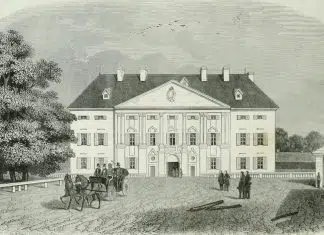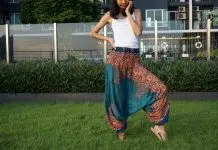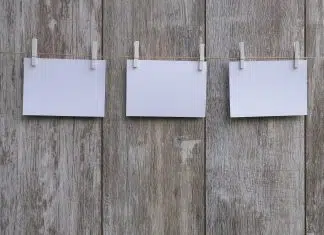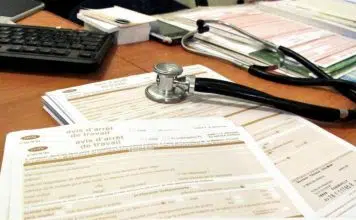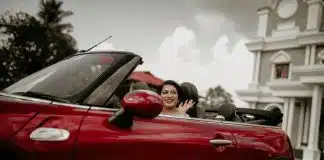A la une
Un outil d’une grande utilité : la pompe à chape
La pompe à chape est un matériau d’une grande utilité qui est surtout utilisé lors des travaux de construction. C’est grâce à ce type...
IMMO & FINANCE
Quel est le salaire moyen au Portugal ?
En 2021, le salaire minimum au Portugal est de 665€, la rémunération minimale a été mise à jour le 1er janvier. Consultez cet article...
Optimisez votre choix avec les meilleures offres d’assurance habitation en ligne
Dans un marché concurrentiel où les options d'assurance habitation sont multiples et variées, les consommateurs se retrouvent souvent désemparés face à la tâche de...
ENTREPRISES
FAMILLE & LOISIRS
Séjour dans un Domaine, un temps d’un dépaysement total
Le séjour dans un Domaine n’est qu’époustouflant et fantastique. Il s’agit même d’un lieu idéal pour festoyer en couple, en famille ou pour passer...
Aura blog sur Facebok
Qui suis-je ?
 Salut tout le monde, je m'appelle Aurore, j'ai 38 ans. Je travaille comme assistante commerciale au sein d'un grand groupe de cosmétique. Et j'adore écrire !
Salut tout le monde, je m'appelle Aurore, j'ai 38 ans. Je travaille comme assistante commerciale au sein d'un grand groupe de cosmétique. Et j'adore écrire !
DERNIERS ARTICLES
ARTICLES PLUS VISITÉS
C’est quoi une fiche individuelle d’état civil et son utilité ?
Lorsque l’on réside hors de son pays de naissance, il est nécessaire de se munir des documents nécessaires. La fiche individuelle d’état civile est...